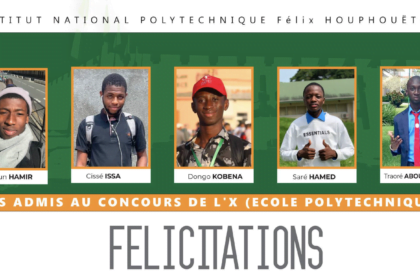Pendant des années, Moscou a présenté le groupe Wagner comme un outil clé pour ramener la sécurité et la stabilité au Sahel. Mais selon une enquête explosive publiée par la plateforme d’investigation The Sentry, la réalité sur le terrain est tout autre : loin d’apporter la paix, les mercenaires russes ont aggravé la crise malienne et se heurtent désormais à une méfiance grandissante de la population.
Du rêve russe au désenchantement malien
En 2017, la Russie entrait en force en Afrique centrale avec le soutien au président centrafricain Faustin-Archange Touadéra, en échange de l’accès à l’or et aux diamants. Fort de ce succès, Moscou a étendu son influence au Mali en 2021, où le colonel Assimi Goïta, arrivé au pouvoir après deux putschs, espérait que Wagner l’aide à combattre à la fois les djihadistes et les rebelles touaregs.
Mais selon Justyna Gudzowska, directrice de The Sentry, le pari malien s’est soldé par un échec cuisant : « La violence extrême de Wagner a permis aux groupes terroristes de renforcer leur contrôle et d’élargir leur recrutement », souligne-t-elle. Pire encore, Wagner n’a pas réussi à sécuriser le nord et le centre du pays, ni à obtenir les licences minières espérées.
Une population trahie
Là où Wagner devait gagner les cœurs, il a semé la terreur. De multiples témoignages dénoncent des exactions et agressions contre les civils. Pour Ulf Lässing, chef du programme Sahel à la Fondation Konrad Adenauer, cette brutalité a sapé la confiance non seulement en Wagner mais aussi en l’armée malienne, accusée d’être complice ou incapable de contrôler ses alliés. Résultat : le lien vital entre l’armée et la population est brisé, compromettant tout effort de stabilisation.
La Turquie, le nouvel arbitre
Alors que Wagner accumule les échecs, un nouvel acteur prend la relève : la Turquie. Grâce à ses drones Bayraktar, désormais déployés par Bamako, le gouvernement malien dispose pour la première fois d’un outil efficace pour surveiller et frapper dans les vastes étendues désertiques du nord. Contrairement aux hélicoptères et jets russes, souvent défaillants, les drones turcs offrent une capacité redoutable et populaire auprès des autorités.
Wagner parti, Afrikakorps arrivé… et après ?
En juin, Wagner a officiellement quitté le Mali, remplacé par l’« Afrikakorps », présenté comme un corps d’instructeurs russes. Mais les analystes jugent improbable une amélioration rapide de la situation. En septembre, une milice affiliée à Al-Qaïda a d’ailleurs détruit plusieurs camions de carburant, renforçant le blocus qui étrangle un pays déjà dépendant des importations.
Un revers stratégique pour Moscou
Pour la Russie, le Mali devait être une vitrine de son modèle d’influence militaire en Afrique. Mais la faillite sécuritaire, économique et sociale laisse place à une profonde désillusion. Pour l’Europe, ce constat pourrait ouvrir de nouvelles marges diplomatiques avec Bamako, dans un contexte où la rivalité entre puissances étrangères se joue désormais à ciel ouvert au Sahel.
👉 Conclusion : L’aventure Wagner au Mali devait incarner la montée en puissance de Moscou en Afrique. Elle ne laisse derrière elle qu’un champ de ruines : une population meurtrie, une armée décrédibilisée, un pays plus vulnérable que jamais face aux djihadistes… et une nouvelle opportunité pour la Turquie de s’imposer comme acteur incontournable du Sahel.