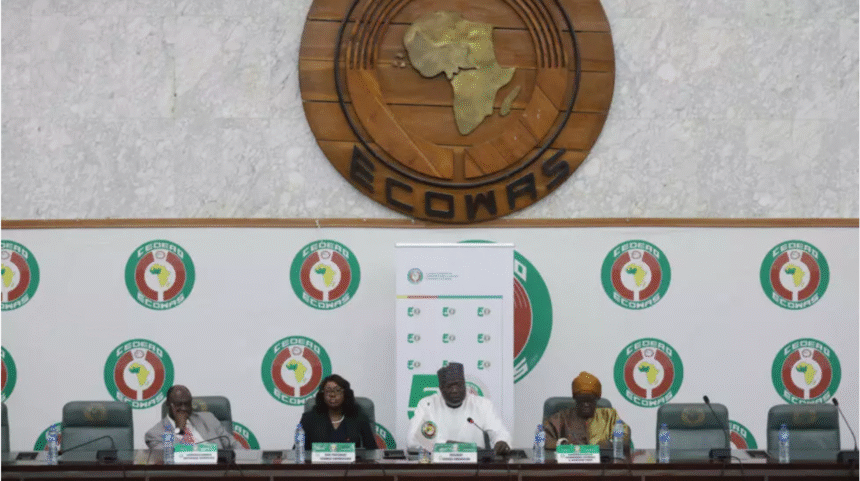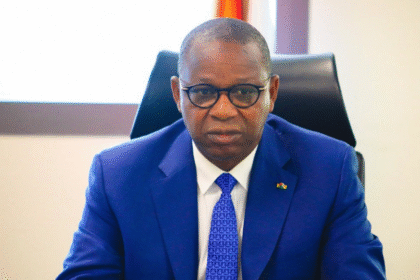La CEDEAO célèbre cette année un demi-siècle d’existence. Les commémorations démarrent ce mardi 22 avril à Accra, là où tout a commencé le 28 mai 1975 à Lagos. Créée pour booster l’intégration économique ouest africaine, l’organisation regroupe aujourd’hui quinze pays… mais traverse une crise sans précédent : le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont claqué la porte. Comment la CEDEAO, symbole d’unité, en est-elle arrivée à ce point de rupture ?
Critiquée et fragilisée, l’organisation ouest-africaine fait face à son plus grand défi depuis sa création. Pourtant, son histoire prouve qu’elle sait rebondir : en 1990, elle invente l’Ecomog pour stopper la guerre au Libéria ; en 1999, elle se dote d’un protocole sur la sécurité, puis en 2001, d’un autre sur la démocratie.
Mais aujourd’hui, submergée par les crises sécuritaires et l’extrémisme violent, la CEDEAO perd pied. « Elle n’était pas préparée à ça », analyse Amandine Gnanguénon, chercheuse à l’Africa Policy Research Institute. « Entre interventions, prévention et perte de contrôle de son agenda, elle s’est laissée déborder. » Résultat ? Des rivaux comme le G5 Sahel ou l’initiative d’Accra lui volent la vedette.
Avec la création de l’AES (Alliance des États du Sahel), la question n’est plus seulement la réforme, mais la survie. Pour rester pertinente, la Cédéao doit renouer avec sa mission originelle : intégration économique, lien avec les populations et communication claire. « Beaucoup ignorent encore son rôle. Il y a un énorme déficit de visibilité », souligne Gnanguénon.
Reste que tout dépend des chefs d’État. La Commission a peu de marge de manœuvre : ce sont eux qui, en dernier ressort, décideront si la CEDEAO se réinvente… ou sombre.
À sa création, la CEDEAO devait être un moteur d’intégration économique. Mais près de 50 ans plus tard, le bilan est mitigé. Si certains projets ont abouti – comme la libre circulation des personnes et des biens, ou la fameuse carte d’identité CEDEAO permettant d’accéder aux emplois privés dans toute la région –, d’autres grands chantiers restent inachevés.
Succès symboliques, échecs structurels
Pour le chercheur sénégalais Pape Ibrahima Kane, l’harmonisation douanière (via la taxe communautaire) et la mobilité régionale sont des « réussites indéniables ». Mais les infrastructures, elles, accusent un retard criant : seul le corridor Abidjan-Lagos tient ses promesses. Résultat ? Le commerce intra-Cédéao plafonne à moins de 15 % des échanges totaux, loin derrière d’autres blocs comme l’UE (60 %) ou l’ASEAN (40 %).
Pourquoi ce blocage ?
Des économies parallèles, pas complémentaires : chaque pays privilégie ses intérêts.
Une monnaie unique fantôme : annoncée, reportée, puis oubliée.
Le Nigeria, locomotive en panne : miné par ses crises internes, il ne joue pas son rôle d’entraînement.
L’effet domino des départs : le retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso fragilise un peu plus le projet commun.
Conclusion cinglante : la CEDEAO a les outils, mais manque de volonté politique. Sans un sursaut collectif, ses ambitions de 1975 risquent de rester… des vœux pieux.